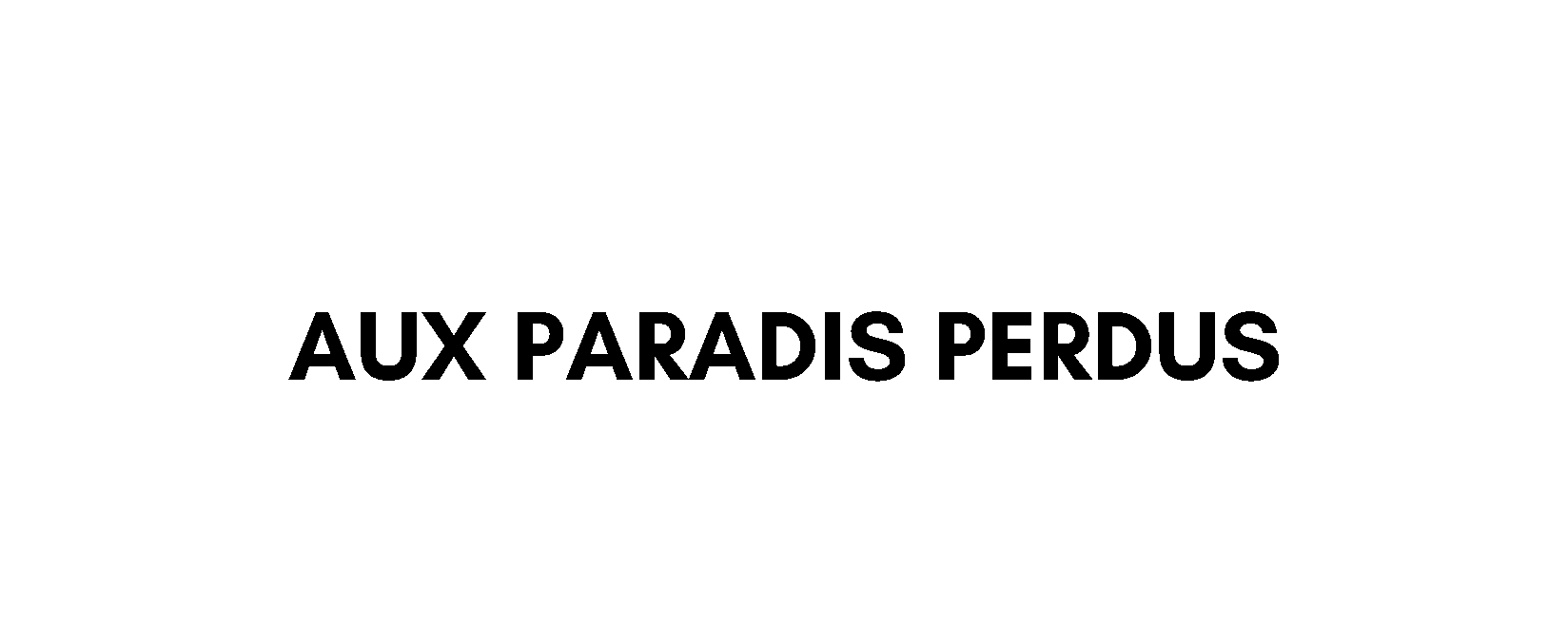Cuisiner en voyage : 8 choses que j’ai apprises
1. Ne planifie pas ton repas avant d’avoir vu la cuisine
Des pâtes. Je voulais juste manger des pâtes. Déjà 5 mois que j’en rêvais : des linguinis au beurre noisette, parmesan, citron et poivre.
Après avoir passé près de 6 mois en Asie, on mettait les pieds en Macédoine, un petit pays des Balkans. C’était la première fois qu’on avait accès à notre propre cuisine depuis le début du voyage.
Je bavais presque en déposant nos sacs sur le seuil de notre petit appartement.
Je me suis empressée d’ouvrir les armoires et les tiroirs de la kitchenette… Et la vue des accessoires à ma disposition a vite freiné mon entrain.
Une plaque chauffante et deux petites poêles. Pas de chaudron ni de casserole, encore moins une passoire.
Et le pire dans tout ça : y’avait même pas d’ouvre-bouteille.
2. Ne planifie pas ton repas avant d’avoir vu l’épicerie
C’est sûrement la partie la plus difficile pour moi. Je suis le genre de fille qui aime bien avoir une liste en poche lorsque je me retrouve dans les rayons d’un marché.
Dans les derniers mois, je ne compte plus le nombre de fois où l’on s’est buté à des étalages d’ingrédients garnis de tout, sauf des ingrédients écrits sur mon petit bout de papier.
C’est vraiment lorsqu’on est privé de fèves vertes, de choux de Bruxelles ou de beurre qu’on réalise à quel point on en a envie.
Les essentiels culinaires ne sont jamais les mêmes d’un pays à l’autre. Alors on n’a pas d’autre choix que d’user de créativité
3. En vrai, ne planifie rien : c’est le temps d’improviser
Pas d’épinards ? On opte pour un chou de Savoie.
Pas de sauce tomate ? On goûte à de l’ajvar, cette pâte de poivrons grillés.
Pas d’haricots noirs en conserve ? On en achète une variété locale… s’il y en a.
Se creuser le coco à l’épicerie, ce n’est que la toute première étape.
Après, en cuisine, les tasses se transforment en louches, le dos d’une cuillère sert à peler les carottes… et le mini coupe-ongles devient un ouvre-boîte, au péril de sa vie.
Dans un autre de nos hébergements, je me suis déjà retrouvée dans une cuisine sans couteau adéquat, sans planche à découper et sans espace de comptoir. Et il fallait que je hache une patate douce.
Imaginez la scène :
Je me suis retrouvée à quatre pattes par terre, à découper ma maudite patate dans une assiette, jurant comme un marin contre un couteau à beurre.
Pas de patience pour tout ça ? Pas le choix d’en trouver.
4. On s’expose à plein de petits trésors.
Cette année, j’ai goûté au boulgour pour la toute première fois. Pour les gens peu familiers, il s’agit d’un grain de blé cuit comme du riz.
Nous étions assis sur la terrasse extérieure d’un esnaf lokantası à Istanbul, ces espèces de cafétérias locales, lorsque je l’ai vu sur le menu.
— C’est peut-être cuit dans du bouillon de poulet… hésite Julien.
— Rendu là, je ne peux pas vraiment contrôler ça… Et j’ai vraiment faim.
Dès la première bouchée, j’ai tout de suite su que ce grain moelleux allait désormais faire partie de mon alimentation quotidienne.
Pourquoi n’y avais-je jamais goûté avant cette année ?
Quelques semaines plus tard, j’ai quasiment sauté de joie lorsque j’en ai déniché dans une petite épicerie albanaise.
La plus grande richesse que 2025 m’ait apportée est définitivement celle d’élargir mes horizons culinaires. Maintenant, j’aime le tempeh, je sais comment cuisiner du soto ayam et j’ai enfin réussi à convaincre Julien de m’acheter un rice cooker.
Une victoire savoureuse.
5. Une alimentation végétarienne à rude épreuve
Je suis la première à l’admettre : cuisiner végé, ça demande souvent plus de temps, plus de planification et plus d’assaisonnement. Quiconque prétend le contraire vous ment.
Je n’ai trouvé un bloc de tofu qu’une seule fois jusqu’à présent, dans une épicerie du Monténégro. Oui, moi aussi, ça m’a surprise !
Mais je me suis résignée à l’acheter.
Mon tofu, je le préfère d’abord congelé, puis décongelé, pressé, déchiré et assaisonné avec de la sauce soja, du vinaigre de riz, de la levure alimentaire, de l’huile de sésame, sel, poivre, ail, gingembre, enrobé dans de la fécule de maïs… bref, vous voyez l’idée.
Bien sûr, je n’ai pas besoin de tout ça, mais c’est ma préférence. Pour que j’apprécie mon tofu, il faut que je sois dans ma propre cuisine — ou quelque part en Asie. Définitivement pas dans les Balkans.
Alors cette année, j’ai plutôt jeté mon dévolu sur les noix de Grenoble et les haricots en conserve. J’ai appris à créer beaucoup avec peu. À cuisiner le plus simplement possible, sans compromettre le facteur satisfaction.
Je n’ai peut-être pas accès aux installations que je voudrais, mais les conditions sont parfaites pour me pousser à innover lorsque je suis aux fourneaux.


Parfois, l’offre dans les restos ne donnne pas vraiment envie…
6. Tu te ramasses à traîner l’équivalent d’une penderie
Ça fait 10 mois qu’on se promène avec deux sacs de 40 L et deux sacs en toile. Le strict minimum, quoi.
Mais dès qu’on a recommencé à cuisiner fréquemment, il a fallu qu’on s’encombre de quelques sacs additionnels pour traîner nos indispensables culinaires.
Parce qu’on a appris, à nos dépens, que les armoires dans les cuisines de logements locatifs sont souvent vides. Vides dans le sens qu’y’a même pas un tupperware qui traîne dans un recoin poussiéreux.
Déjà qu’on s’encombre avec notre huile d’olive, du sel, du poivre, des épices, un fond de beurre, du vinaigre balsamique, des cubes de bouillon, du miel qui coule partout, une boîte de granola à moitié entamée, une couverture, des aimants à frigo et beaucoup trop de cartes postales, faudrait que je rajoute à tout ça des contenants en plastique cheap, dénichés à l’équivalent local du Dollarama ?
J’ai mes limites.
Je préfère traîner, en plus de tout ça, un contenant de yogourt, vieux de trois pays déjà, pour accueillir mes restes de soupe.
7. Gérer les restes : place au casse-tête
Parlant de restes : la capacité d’un pot de yogourt de 750 g, elle aussi, a ses limites. Et les micro-ondes sont une denrée extrêmement rare dans les cuisines nord-américaines… euh non, non nord-américaines.
Concernant le premier, c’est l’enjeu le plus irritant. Lorsque je me résous à foutre notre unique chaudron dans un mini-frigo pour sauver le chili, ou qu’on étire la soupe 3 soirs d’affilée puisqu’elle monopolise l’entièreté de la batterie de cuisine, je grogne un peu.
Pour ce qui est du second, si j’avais les bons outils sous la main, ça irait. Donnez-moi une poêle à frire assez large et profonde pour la transformer en bain-marie et pouvoir y déposer une assiette au milieu, et je gère.
Le hic, c’est que bien souvent, y’a même pas assez d’assiettes pour nous deux. J’en demande peut-être beaucoup avec la poêle.
8. On a de la chance au Québec, quand même
Quand je pense à la maison, quand je pense à Montréal, je me dis qu’on a de la chance.
Notre coin de pays est loin d’être parfait.
Reste que je peux sortir de mon appartement, marcher jusqu’au coin de ma rue et tomber sur trois différentes sortes de pâte harissa, des jarres de citrons confits au sel et des rayons remplis d’épices provenant des quatre coins du monde.
Pas dans une épicerie bio hors de prix, ni dans un magasin ultra spécialisé.
Dans ma petite fruiterie de quartier.
Je sais que cette expérience est très loin de pouvoir s’extrapoler à l’ensemble du Québec.
Mais quand même, pour une ville de sa taille, je me rends compte que Montréal se trouve dans une ligue à part. On réussit à y trouver notre compte : des épiceries asiatiques, arabes, espagnoles, est-européennes, indiennes — et j’en passe — y’en a à la pelletée.
Si seulement on pouvait prendre conscience d’à quel point c’est cette mixité, cette richesse culturelle, qui donne à notre ville sa saveur complètement unique.
Ça, pis la poutine.